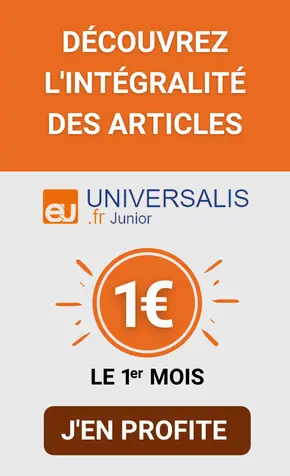Le complexe d’Auschwitz-Birkenau est le symbole de la politique d’extermination mise en place par l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans ce très[...]
Trois lieux distincts
Le complexe est situé à proximité de la ville d’Oswiecim, en allemand Auschwitz, en Haute-Silésie, dans la Pologne annexée par[...]
Auschwitz I
Le camp principal, Auschwitz I, est créé en mai 1940 dans une ancienne caserne de l’armée polonaise. Il sert initialement de centre de détention pour les prisonniers politiques polonais. Installé à proximité de la ville, c’est un réservoir de main-d’œuvre mis à disposition des projets de développement urbain, industriel et agricole du territoire alentour. Il abrite également des logements pour le personnel et les infrastructures[...]
Auschwitz II-Birkenau
Construit à environ 3 kilomètres du camp principal, celui d’Auschwitz II-Birkenau est ouvert au début de 1942. Destiné initialement à accueillir des prisonniers de guerre soviétiques, c’est le plus grand camp du complexe, à la fois camp de travail et centre de mise à mort.
Son choix comme lieu d’extermination s’explique notamment par l’expérience de Rudolf Höss, le commandant d’Auschwitz, et de son personnel en matière d’assassinat par gazage. Après la décision, prise en janvier 1942, de mettre en place la « solution finale » de la question juive, les nazis rationalisent les opérations d’extermination. Des grands bâtiments, les crématoires II et III, associant chambres à[...]
Auschwitz III-Monowitz
Un dernier camp, appelé Auschwitz III, également connu sous le nom de Monowitz, est établi dès octobre 1942 près de la ville de Monowice, à 5,5 kilomètres des deux premiers. Ce camp de travail forcé fournit[...]
Les conditions de vie à Auschwitz
Au début de la guerre, les déportés emprisonnés dans le camp I sont mis au travail, notamment pour la construction et l’extension du site. Dans le camp II, à l’arrivée des convois, le plus souvent des trains de marchandises, les déportés sont sélectionnés directement sur le quai, appelé la « rampe » : ceux qui sont jugés inaptes au travail (comme les enfants et les vieillards) sont immédiatement dirigés vers les chambres à gaz ; les autres sont envoyés vers des baraquements où ils doivent se débarrasser de tous leurs biens avant d’être rasés et tatoués d’un numéro qui permet de les identifier (les trois camps du complexe d’Auschwitz sont les seuls où les détenus sont tatoués par les nazis). Les gardes SS font régner la terreur. Les violences physiques et psychologiques sont constantes, lors par exemple des interminables appels dans le froid. Les punitions sont arbitraires et les exécutions sommaires nombreuses.[...]
La libération des camps
Face à l’avancée soviétique, le chef de la SS Heinrich Himmler donne, en novembre 1944, l’ordre d’arrêter les gazages à Auschwitz et de détruire les preuves des crimes, notamment en dynamitant les chambres à gaz et les crématoires. Le 17 janvier 1945, les derniers prisonniers restants et capables de marcher sont évacués[...]
La mémoire d’Auschwitz et des génocides
Les camps d’Auschwitz occupent une place à part dans la solution finale, car c’est le site où il y eut le plus de victimes et le centre de mise à mort ayant fonctionné le plus longtemps, de juin 1942 à novembre 1944. C’est aussi celui qui a accueilli le plus de déportés, soit 1,3 million de personnes, venant de toute l’Europe. Le génocide des Juifs (ou Shoah) et celui des Tziganes y ont en grande partie eu lieu. Sur 1,1 million de victimes assassinées qui ont été dénombrées, 960 000 étaient d’origine juive ; 69 000 des 76 000 Juifs de France déportés y ont trouvé la mort.
Les témoignages des survivants et les documents[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter